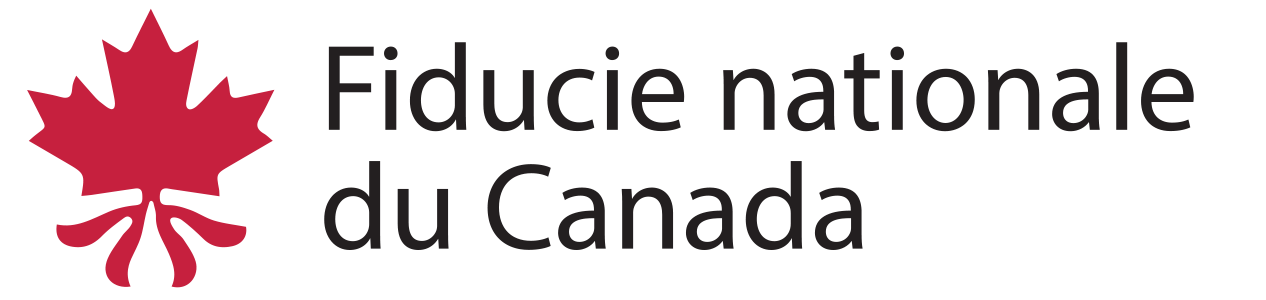Liste des lieux menacés 2025
Le 8 octobre, la Fiducie nationale du Canada a affiché sa Liste des lieux menacés 2025 à l’échelle nationale, soit dix lieux patrimoniaux à risque, d’un océan à l’autre. Les lieux retenus cette année mettent en lumière les défis systémiques qui touchent le patrimoine au pays : des protections législatives insuffisantes pour notre patrimoine collectif, une diminution du financement accordé aux lieux patrimoniaux et une négligence chronique à long terme.
Depuis une vingtaine d’années, la Liste des lieux menacés constitue un puissant point de ralliement pour les communautés et les défenseurs du patrimoine déterminés à sauver les lieux qui racontent l’histoire du Canada. Depuis sa création, la Liste a révélé les problèmes profonds qui menacent ces lieux : les effets des changements climatiques, le sous-financement chronique et le nombre excessif de démolitions comme « solutions rapides » pour effacer plutôt que restaurer. Même si ces lieux sont à risque, ils ont un immense potentiel de conservation.
Élaborée à partir des nominations du public ainsi que de recherches continues et d’une veille médiatique menée par la Fiducie nationale, cette Liste des lieux menacés du 20e anniversaire met en valeur une remarquable diversité de lieux patrimoniaux : qu’il s’agisse de symboles nationaux, comme la résidence officielle du premier ministre du Canada, de repères industriels, des écoles historiques et des lieux de culte qui ancrent nos communautés depuis des générations.
Lorsqu’un lieu patrimonial disparaît, nous perdons bien plus que des murs et des pierres : nous perdons une partie de la fondation qui façonne notre identité en tant que Canadiens et Canadiennes. À mesure que des lieux patrimoniaux disparaissent partout au pays, notre mémoire collective s’efface, notre identité commune s’affaiblit et des ressources précieuses sont gaspillées.
Les membres des communautés, les défenseurs du patrimoine et les dirigeants locaux peuvent utiliser la Liste des lieux menacés comme un catalyseur, pour faire entendre leur voix, s’organiser et agir avant que ces lieux ne soient perdus à jamais.
le 24, promenade Sussex (Ottawa, Ontario)

Photo: Le 24, promenade Sussex | Commission de la capitale nationale
Le 24, promenade Sussex, adresse de la résidence officielle du premier ministre du Canada, est sans contredit l’adresse la plus connue au pays. Construite en 1867 et désignée comme « édifice fédéral du patrimoine classé » en 1986, la maison a servi de résidence officielle du premier ministre du Canada depuis 1951. Des réceptions diplomatiques en passant par les discours télévisés, il va sans dire que la résidence a occupé une place importante dans la vie politique nationale.
Selon un rapport de la Commission de la capitale nationale (CCN) publié en 2021, la résidence, inoccupée depuis 2015, se trouve dans un « état critique ». Des travaux d’enlèvement et de mise hors service s’élevant à 4,3 millions de dollars ont été menés à bien en 2024. Ces travaux comprenaient la suppression de l’amiante et d’autres matières dangereuses, le renforcement de l’isolation, ainsi que le retrait soigneux et l’entreposage d’éléments patrimoniaux tels que les portes et les moulures d’origine. Les pièces qui revêtaient une trop grande importance patrimoniale, dont la salle à manger et la bibliothèque, ont été minutieusement protégées pendant les travaux.
Il existe de nombreuses options pour l’avenir du bâtiment patrimonial, mais le gouvernement fédéral tarde à prendre une décision. À la mi-année 2025, la résidence officielle du premier ministre était encore à l’abandon. Sans occupants ni vocation claire, l’état du bâtiment continuera de se dégrader et l’avenir de celui-ci restera incertain. L’indécision du gouvernement menace ce joyau patrimonial.
La lente détérioration du 24, promenade Sussex a été causée par bien plus que de simples retards dans les travaux d’entretien. La loi fédérale visant à protéger les lieux patrimoniaux est morte au feuilleton lors de la dernière session parlementaire. À l’heure où les symboles de l’identité canadienne et les projets d’importance nationale sont plus nécessaires que jamais, il est temps que le gouvernement fédéral fasse preuve de leadership en matière de protection des lieux patrimoniaux.
le magasin de la Compagnie de la Baie d’Hudson (Calgary, Alberta)

Photo: La Baie – The Bay, Calgary | Abdallahh, 2010, CC BY 2.0
Situé bien en évidence dans l’arrondissement historique de l’avenue Stephen, le magasin de la Compagnie de la Baie d’Hudson est l’un des édifices commerciaux les plus importants sur le plan architectural et historique de l’Ouest canadien. Ce bâtiment emblématique de six étages à l’architecture édouardienne, dont la construction a été achevée en 1913 et qui a été agrandi par la suite en 1930 et en 1958, a été conçu par le célèbre cabinet d’architectes torontois Burke, Horwood and White. Il se distingue par sa construction massive de style commercial (ou Chicago), son revêtement rare en terre cuite vernie de couleur crème, ses colonnes de granit et sa colonnade majestueuse, qui ont fait de lui un joyau de l’architecture des grands magasins du début du 20e siècle et la première grande structure commerciale en béton de Calgary. Ayant servi de prototype national, le magasin de la Compagnie de la Baie d’Hudson à Calgary a servi d’inspiration pour des magasins phares à Vancouver, Victoria et Winnipeg — ouvrant la voie à un empire commercial dans l’Ouest canadien.
La chute de la Compagnie de la Baie d’Hudson a mis cet édifice, mais aussi d’autres édifices emblématiques de la Baie, en péril. Maintenant inoccupé, le magasin de Calgary fait face à un avenir incertain. La Compagnie de la Baie d’Hudson a annoncé la fermeture que la quasi-totalité de ses magasins partout au Canada. En outre, le gardien financier du magasin de Calgary a annoncé plus tôt cette année qu’il n’injecterait plus de capitaux dans le bâtiment. Dans d’autres villes, dont Winnipeg, on donne une seconde vie à d’anciens magasins de la Baie, qui sont transformés en immeubles à logements ou en centres culturels.
Pourtant, en dépit de sa valeur architecturale et de son legs social important, le magasin de Calgary n’a pas de désignation patrimoniale officielle, ce qui ouvre la porte à la démolition et au réaménagement.
la maison du Dr Martin Murphy (Halifax, N.-É.)

Photo: la maison du Dr Martin Murphy | Ian Bezanson
Construite en 1860 sur ce qui était autrefois des terres agricoles et qui est devenu aujourd’hui le centre-ville de Halifax, la maison du Dr Martin Murphy est le plus récent exemple d’un bien du patrimoine dont l’avenir est compromis en raison des difficultés grandissantes à contracter une assurance.
La maison, à l’origine une habitation modeste d’un étage et demi, doit son nom au Dr Martin Murphy, un ingénieur municipal éminent qui a acheté la propriété en 1877. Puis, de 1900 à 1917, Edward Maxwell, un entrepreneur et un maçon né à Halifax, ferait subir une transformation radicale à la maison. Il ajouterait un second étage, des fenêtres en baie et une rangée de maisons en brique au style distinctif.
Encore de nos jours, la maison du Dr Martin Murphy est un élément caractéristique du paysage urbain du quartier. Le propriétaire actuel a soigneusement entretenu la maison : il a notamment restauré le revêtement en bois d’origine et reconstruit l’entrée principale en préservant son cachet historique.
Toutefois, malgré sa grande importance architecturale et son entretien rigoureux, la maison du Dr Martin Murphy est devenue un autre symbole d’un problème croissant à l’échelle nationale : la difficulté grandissante à laquelle sont confrontés les propriétaires de maisons à désignation patrimoniale pour souscrire à une assurance adéquate. En 2023, le fournisseur de l’assurance habitation du propriétaire a résilié la police avec un préavis d’à peine 30 jours. Plusieurs courtiers ont essayé en vain de trouver une autre assurance en raison de l’âge de la maison et de sa désignation patrimoniale.
Une meilleure compréhension et une coordination accrue entre les compagnies d’assurance, les courtiers et les autorités chargées de la désignation sont primordiales. On croit souvent à tort qu’une désignation patrimoniale exige une reconstruction historique exacte en cas de sinistre. Dans les faits, les lois en matière de protection du patrimoine varient grandement d’une compétence à l’autre et permettent souvent une certaine souplesse en ce qui a trait à la restauration ou à la reconstruction d’un bien patrimonial.
Beaucoup de propriétaires de maisons anciennes et patrimoniales sont incapables de contracter une assurance normale — un obstacle qui empêche aussi les acheteurs potentiels d’obtenir un prêt hypothécaire. Sans accès à une assurance à prix abordable, la maison du Dr Martin Murphy et bien d’autres des 1,5 million d’habitations datant d’avant 1945 au Canada sont menacées.
le site historique national de la briqueterie de Claybank (Claybank, Saskatchewan)

Photo: le site historique national de la briqueterie de Claybank | Brad Taylor
Niché au cœur du paysage spectaculaire des Dirt Hills dans le sud de la Saskatchewan, le site historique national de la briqueterie de Claybank compte parmi les sites les plus visités et les mieux préservés du début de l’ère industrielle au Canada. En activité de 1914 à 1989, la manufacture a produit certaines des briques réfractaires et des briques de parement de la plus haute qualité en Amérique du Nord — des matériaux utilisés à des fins multiples, des locomotives à vapeur en passant par les aciéries et des bâtiments emblématiques tels que le Château Frontenac de Québec. Aujourd’hui, la manufacture est l’un des exemples les plus notables de la fabrication de briques au début du 20e siècle au Canada.
Reconnu pour son importance à l’échelle tant provinciale que nationale, le site a obtenu plusieurs désignations patrimoniales et de vastes travaux de conservation y ont été réalisés. Depuis le début des années 1990, près de 3,8 millions de dollars — dont 2,1 millions provenaient du gouvernement de la Saskatchewan — ont été investis pour préserver ses bâtiments et ses fours historiques.
Malgré ces efforts, l’avenir de la briqueterie de Claybank reste incertain. En l’absence d’un modèle de financement durable à long terme, le site tombe petit à petit en décrépitude. L’entretien est effectué désormais presque exclusivement par un petit groupe de bénévoles engagés, qui disposent de ressources limitées. Sans le renouvellement des investissements publics et sans une stratégie de gestion coordonnée, ce site important du patrimoine industriel risque de disparaître.
la zone du lot 500 (Charlottetown, I.-P.-É.)

Photo: la zone du lot 500 | Stuart Lazear
La zone du lot 500, qui s’étend de la rue Euston jusqu’au front de mer de Charlottetown, forme le centre historique de la capitale de l’Île-du-Prince-Édouard. Le quartier abrite certains des bâtiments les plus anciens et les plus importants sur le plan architectural et culturel de la ville — que ce soit des maisons individuelles datant de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle, ou de somptueuses demeures comme la Maison Beaconsfield, ou bien des églises datant d’avant la Confédération, ou bien encore la Province House, le site de la Conférence de Charlottetown de 1864, qui a été désigné lieu historique national. Ces bâtiments emblématiques reflètent les racines coloniales, l’engagement civique et le rôle de longue date de Charlottetown comme centre politique et culturel de la province.
Désignée « zone protégée du patrimoine » en 1979, la zone du lot 500 a obtenu une reconnaissance nationale en 2005 lorsque la ville a reçu le Prix du prince de Galles pour son engagement à préserver le patrimoine depuis plusieurs décennies. En 2013, les mesures de protection ont été étendues et le plan officiel de la ville à l’époque indiquait de toute démolition dans le quartier ne serait en principe « pas autorisée ».
Néanmoins, en 2018, les mesures de protection pour la zone du lot 500 ont été affaiblies de manière considérable. La ville ne reconnaît plus officiellement la zone du lot 500 comme une « zone protégée du patrimoine » ou comme un regroupement de « ressources patrimoniales désignées ». En 2024 seulement, on a démoli ou approuvé la démolition de six édifices de la zone, qui étaient autrefois protégés par l’ancien règlement municipal.
Un grand nombre des bâtiments du quartier patrimonial de Charlottetown appartiennent maintenant à de grandes sociétés immobilières et de gestion immobilière, parmi lesquelles plusieurs ont laissé les édifices historiques tomber en décrépitude — car elles sous-estiment leur valeur patrimoniale — afin de réaliser des projets de réaménagement qui prévoient des ensembles d’‘habitations collectives à plus forte densité. Ces projets ne prennent souvent pas en compte la manière dont les zones patrimoniales, comme la zone du lot 500, peuvent être adaptées afin de créer des solutions de logement plus abordables et plus durables. Beaucoup des maisons historiques du quartier se prêtent bien à une transformation en immeubles à logements multiples ou en logements secondaires. De même, les terrains pourraient se prêter à des projets réfléchis d’‘aménagement de l’‘espace inutilisé, qui augmenteraient la densité tout en conservant le caractère du secteur. Quant aux plus grands édifices patrimoniaux, ils pourraient être modifiés en immeubles à usage mixte (commercial et résidentiel) tout en préservant la structure et le dynamisme du quartier. Avec des adaptations bien pensées, ces bâtiments pourraient répondre aux besoins de la communauté sans sacrifier les matériaux de haute qualité et le savoir-faire qui les rendent irremplaçables.
Sans des mesures de protection plus strictes s’appliquant à toute la zone, les efforts de préservation se limiteront à des combats séparés pour un bâtiment à la fois, une approche ayant peu de chances de prévenir la perte d’autres biens du patrimoine.
l’immeuble Peck (Winnipeg, Manitoba)

Photo: l’immeuble Peck | Gordon Goldsborough
Érigé à l’angle de l’avenue Notre– Dame et de la rue Princess dans le lieu historique national du Quartier-de-la-Bourse à Winnipeg, l’immeuble Peck, qui compte six étages, est un exemple remarquable du style néo-roman. Conçu par l’architecte de formation britannique Charles H. Wheeler et achevé en 1893, l’immeuble se distingue par les détails de ses murs en briques, ses contreforts en pierre calcaire, ses accents de grès rouge et ses voûtes arrondies — toutes des marques caractéristiques du style. En 1907, un architecte local du nom de John Danley Atchison a supervisé l’ajout de deux étages, tout en préservant soigneusement l’intégrité architecturale du bâtiment. Les têtes sculptées avec minutie et les autres ornements contribuent encore davantage à faire de l’immeuble Peck un bâtiment emblématique qui sert de porte d’entrée de l’un des quartiers patrimoniaux les plus importants du Canada.
Commandé en 1893 par le marchand John W. Peck pour y installer sa manufacture de vêtements établie à Montréal, l’immeuble a été agrandi en 1907 pour s’adapter au secteur commercial en pleine croissance. Au fil des décennies, l’immeuble a abrité un vaste éventail d’occupants et il s’est imposé comme un élément durable du quartier de la Bourse, devenu l’un des quartiers patrimoniaux les mieux préservés du Canada sur le plan architectural. La ville en a fait un site patrimonial désigné en 1984.
En dépit de sa désignation patrimoniale et de son emplacement de premier choix, l’immeuble Peck est vide depuis maintenant beaucoup d’années. En 2007, l’Église de scientologie a fait l’acquisition de l’immeuble avec l’intention de le transformer en église régionale et en espace de bureaux de 10 millions de dollars — un projet qui n’a jamais vu le jour. Depuis, l’immeuble est inoccupé et laissé en proie aux dégâts d’eau, aux actes de vandalisme, aux incendies et à la détérioration structurelle, qui sont tous des risques connus de l’inoccupation à long terme.
Aujourd’hui, en l’absence de plan de restauration ou de réutilisation adaptative, l’avenir de l’immeuble Peck est compromis. De plus, le fait qu’il soit laissé à l’abandon depuis longtemps soulève des inquiétudes plus larges quant au sort réservé aux bâtiments phares des quartiers historiques, et montre à quel point il est urgent de renforcer les mécanismes afin de prévenir la lente disparition du patrimoine architectural du Canada.
l’église Saint-Joseph d’Alma (Alma, Québec)

Photo: l’église Saint-Joseph d’Alma | François Viel
Surplombant la ville d’Alma dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean au Québec, l’église Saint-Joseph d’Alma est un remarquable exemple de l’architecture religieuse du début du 20e siècle. Construit de 1907 à 1908 pendant une période d’expansion rapide de l’Église catholique au Québec, ce bâtiment patrimonial a été conçu par l’architecte René-Pamphile Lemay et construit par l’entrepreneur Joseph Giroux. Son style éclectique, une caractéristique de l’époque, reflète les ambitions d’une communauté en pleine croissance et a fait de l’église un emblème central de la vie spirituelle et citoyenne pendant plus d’un siècle à Alma. Le savoir-faire régional, les matériaux locaux et les aspirations architecturales mettent en évidence l’importance de l’église Saint-Joseph d’Alma tant comme monument religieux que comme monument culturel.
Au cours des quatre dernières années, plus de 1,4 million de dollars ont été investis pour restaurer et stabiliser la structure. Cependant, des réparations urgentes estimées à 550 000 dollars restent à effectuer avant que l’église ne puisse rouvrir ses portes en toute sécurité. Or, en juin 2025, le Ministère de la Culture et des Communications du Québec a suspendu abruptement tous les fonds alloués à la restauration et à réutilisation adaptative des bâtiments du patrimoine religieux, interrompant ainsi la dernière phase de la reconstruction de l’église Saint-Joseph d’Alma et mettant son avenir en péril.
L’impasse dans laquelle se trouve le projet de restauration de l’église n’est que la pointe de l’iceberg de la crise qui menace le patrimoine bâti religieux du Québec. Avec la fin du financement public et le déclin des congrégations religieuses, des centaines d’églises et de bâtiments connexes risquent de se détériorer ou d’être démolis partout dans la province. La réputation exemplaire du Québec en matière de protection de son riche patrimoine religieux ne tient plus qu’à un fil.
la Maison Pascal-Poirier (Shediac, Nouveau-Brunswick)

Photo: la Maison Pascal-Poirier | The Town of Shediac
Construite en 1825, la Maison Pascal-Poirier est la plus vieille maison de Shediac, au Nouveau-Brunswick. Cette maison à pignons à un étage et demi est un rare exemple de l’architecture traditionnelle acadienne et revêt une grande importance culturelle puisqu’‘il s’agit du lieu de naissance et de résidence de Pascal Poirier (1852-1933), un leader et un auteur acadien réputé, et le premier Acadien nommé au Sénat canadien en 1885.
La maison a conservé bon nombre de ses éléments d’origine, notamment ses éléments structurels taillés à la main, ses fenêtres en verre du 19e siècle, son vestibule central traditionnel et sa finition extérieure de style néoclassique, qui comprend une véranda avec un porche d’entrée vitré — des éléments qui augmentent tous sa valeur patrimoniale exceptionnelle.
Malgré son importance historique et architecturale, la Maison Pascal-Poirier reste fermée au public depuis la pandémie de COVID-19 et montre des signes inquiétants de détérioration. Propriété de la ville de Shediac, la maison a été chauffée le moins possible pour prévenir des dommages, mais le fait qu’elle a été inoccupée et peu entretenue n’a fait qu’aggraver la situation.
En 2022, la ville a annoncé qu’elle avait mené une étude de faisabilité pour déterminer les options possibles pour la restauration de la maison historique. À ce jour, il n’existe toujours pas de plan de restauration détaillé et selon les évaluations, il en coûterait plus de 500 000 dollars pour stabiliser et préserver la structure, sans compter les autres investissements nécessaires pour la réutilisation adaptative. En 2025, des membres de la communauté ont formé un comité chargé d’étudier le potentiel de la maison et de formuler des recommandations au conseil municipal sur la façon de procéder.
Les défenseurs du patrimoine préviennent que le site fait face à un problème commun à beaucoup de lieux patrimoniaux partout dans la province : sans entretien régulier et sans investissement, les bâtiments tombent en ruine. Ces inquiétudes font écho à celles exprimées par les gestionnaires de sites historiques au Nouveau-Brunswick l’été dernier, après qu’une publicité touristique diffusée à la grandeur de la province a encouragé les visiteurs à découvrir les lieux patrimoniaux du Nouveau-Brunswick, et ce, malgré qu’un nombre sans précédent de coupes budgétaires ait contraint certains sites de fermer leurs portes.
Sans intervention immédiate, l’un des sites historiques acadiens les plus importants de la région risque de tomber dans les griffes d’un déclin irréversible.
le couvent des Sœurs de la Visitation (Ottawa, Ontario)

Photo: le couvent des Sœurs de la Visitation | Avec l’autorisation de Patrimoine Ottawa.
Connu par les gens de la région comme les « Ormes », l’ancien couvent des Sœurs de la Visitation est un rare et remarquable exemple de l’architecture vernaculaire néo-gothique à Ottawa. Construit entre 1864 et 1865, puis agrandi en 1913, l’édifice, avec ses ailes disposées autour d’une cour isolée, a abrité pendant plus d’un siècle un ordre de religieuses cloîtrées. Protégé en vertu de la Partie IV de la Loi sur le patrimoine de l’‘Ontario, le couvent est à la fois un site emblématique et un lieu de mémoire du patrimoine religieux et architectural d’Ottawa.
Depuis que la propriété a été vendue à Ashcroft Homes en 2009, deux grands complexes domiciliaires ont été construits sur les terrains de l’ancien couvent pour faire place à une communauté au cœur de laquelle se trouve le bâtiment historique. Or, celui-ci est inoccupé, a été condamné et tombe peu à peu en ruine. La détérioration de la structure s’est accélérée, comme le montrent des fissures importantes dans la fondation, ce qui a incité la Ville d’Ottawa à exiger que des évaluations techniques et des réparations d’urgence soient effectuées.
Le propriétaire, Ashcroft Homes, a été placé sous séquestre. Le couvent et les terrains vacants restants, eux, ont été mis en vente. Nul ne sait si le nouveau propriétaire respectera les mesures de protection en vigueur ou s’il s’engagera à réaliser un projet de restauration patrimoniale. Sans des mesures urgentes de stabilisation et une vision claire, axée sur la conservation et la réutilisation adaptative, l’avenir de ce site patrimonial de grande importance est profondément incertain.
l’école de l’avenue Spruce (Edmonton, Alberta)

Photo: l’école de l’avenue Spruce | Dali Mwanza
L’école de l’avenue Spruce, un immeuble en briques de deux étages dont la construction remonte à 1928, est un bâtiment subsistant de l’architecture institutionnelle du début du 20e siècle dans le quartier historique du centre-nord d’Edmonton. Construite à l’origine sur l’une des terres de la Compagnie de la Baie d’Hudson, l’école a accueilli plusieurs générations d’élèves et a servi de centre communautaire pendant près d’un siècle. Sa conception est le reflet d’une époque où les édifices publics devaient être des symboles de pérennité et de fierté civique, et plusieurs ajouts ont été faits au fil des décennies afin de répondre à la croissance démographique, surtout pendant l’après-guerre.
En 2024, la division scolaire Edmonton Public Schools a annoncé son intention de démolir l’école de l’avenue Spruce et de la remplacer par une nouvelle école qui accueillerait des élèves de la maternelle à la 9e année, un projet s’inscrivant dans le cadre du programme d’accélération de la construction d’infrastructures scolaires de l’Alberta. La décision de reconstruire plutôt que de rénover a été présentée comme finale et sans appel lors d’une réunion communautaire de laquelle étaient exclus les habitants de la région, les inquiétudes liées à la préservation ayant été rejetées, car elles n’entraient pas dans le cadre de la discussion. Depuis, les visites du site et les travaux préparatoires ont bien avancé malgré une forte opposition du voisinage, des défenseurs du patrimoine et d’anciens élèves.
Les membres de la communauté ont fait état de leur profonde déception vis-à-vis la perte potentielle d’un bâtiment qui constituait un élément essentiel de l’identité du quartier. De plus, bon nombre d’entre eux ont déploré le fait qu’ils avaient été exclus du processus décisionnel et se sont dits inquiets de l’impact que le nouveau projet de construction pourrait avoir sur le voisinage. L’école de l’avenue Spruce n’est que l’un des nombreux bâtiments scolaires qui risquent d’être démolis au Canada, malgré les possibilités de réutilisation adaptative.