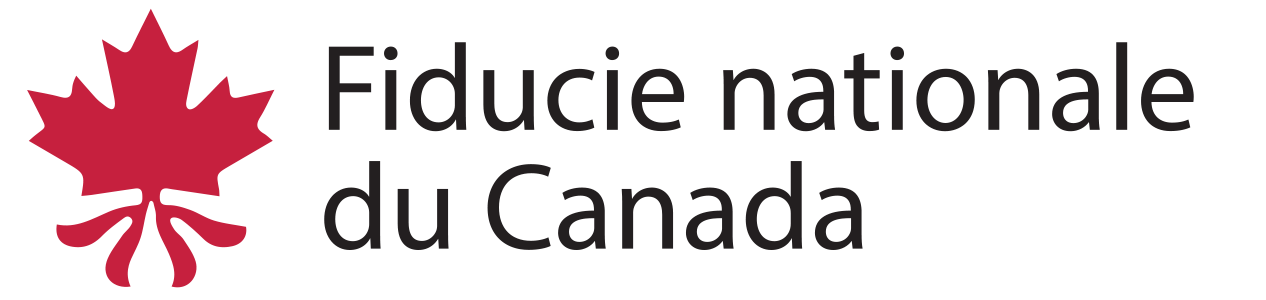Rapport de recherche sur les lieux de culte d’Ottawa face aux défis de l’intégration communautaire
Les lieux de culte canadiens ont longtemps été les pierres angulaires de nos communautés. Au fil des générations, ils ont façonné le paysage culturel et matériel de nos quartiers. Même si leur rôle fondamental est de servir leurs congrégations, nombre de lieux de culte du Canada jouent également le rôle de centres communautaires, où ils mettent gratuitement ou à peu de frais des espaces, des ressources et des services à la disposition des résidents et des associations communautaires. Ils constituent également des monuments historiques qui témoignent du patrimoine local et contribuent à renforcer le sentiment d’identité commune au sein de la communauté.
Ces dernières années, le rôle social et culturel important que jouent les bâtiments à caractère religieux dans leurs communautés locales a montré des signes de déclin. Les changements dans les pratiques religieuses ont fait vieillir les congrégations et ont mis à mal leurs ressources financières, ce qui a entraîné la fermeture de nombreux édifices religieux dans tout le pays.[1] Au-delà des groupes religieux, cette perte met aussi en péril le travail des organismes locaux qui comptent sur les loyers bas, l’emplacement central et l’espace disponible dans ces bâtiments pour offrir des services sociaux essentiels et des activités artistiques et culturelles.
Les organisations communautaires dynamiques sont nombreuses à Ottawa et elles exercent leurs activités depuis des lieux de culte. Des initiatives comme l’Initiative multiconfessionnelle pour le logement (Multifaith Housing Initiative), le Centre 507 et l’Alliance canadienne pour mettre fin à l’itinérance (Canadian Alliance to End Homelessness) dépendent de ces bâtiments pour offrir des services aux populations vulnérables de la ville. Une multitude d’organismes à but non lucratif, des troupes de théâtre et chorales aux programmes jeunesse, en passant par les clubs sportifs et les réseaux de soutien aux toxicomanes, dépendent aussi de ces lieux, dont l’accessibilité et le prix abordable sont essentiels. Face à la hausse des loyers dans toute la ville, disposer de lieux de culte est devenu une nécessité pour les organisations qui, autrement, risqueraient de ne plus pouvoir se permettre les locaux dont elles ont besoin pour fonctionner.
Les organismes communautaires d’Ottawa ont rapporté à la Fiducie nationale que malgré le besoin évident et croissant d’espaces abordables, le nombre de communautés religieuses qui leur ouvrent leurs portes a considérablement diminué pendant et après la pandémie de Covid-19. Les consultations menées auprès de différentes communautés religieuses ont révélé que beaucoup d’entre elles étaient peu disposées à partager leurs locaux, estimant que des obstacles physiques, financiers, opérationnels ou culturels les empêchaient de les ouvrir au grand public pour un usage partagé. Quant à savoir dans quelle mesure ces hypothèses reflètent la réalité, cela reste à voir. Cet écart est devenu le moteur de ce rapport. Le manque d’engagement envers les communautés environnantes contribue depuis trop longtemps à la vulnérabilité des lieux de culte d’Ottawa et les met en péril.
En mettant leurs bâtiments à la disposition de groupes communautaires locaux à des tarifs de location abordables, les communautés religieuses génèrent des revenus essentiels pour couvrir leurs coûts d’exploitation et d’entretien. Elles contribuent ainsi à la pérennité de ces lieux, tout en freinant le cycle de fermetures et de démolitions qui les menace. Les communautés religieuses qui évitent de s’engager risquent de passer à côté d’occasions précieuses qui leur permettraient non seulement d’améliorer leur situation financière et de renforcer leurs liens avec la communauté au sens large, mais aussi de préserver ces bâtiments historiques.
Afin de mieux comprendre les obstacles que les communautés confessionnelles d’Ottawa associent au partage de leurs espaces avec des organismes communautaires, et afin de pouvoir formuler ensuite des recommandations ainsi que des outils pour soutenir de futurs partenariats, la Fiducie nationale du Canada a mené une étude visant à identifier ces freins et les moyens de les surmonter.
Les données ont été recueillies au moyen de sondages en ligne, d’entrevues et de séances de coaching menées auprès de quatre lieux de culte et de douze organismes communautaires d’Ottawa. Leurs réponses ont ensuite été analysées et comparées afin de faire ressortir les obstacles les plus souvent mentionnés, ainsi que les différences marquées dans la perception qu’en ont les deux groupes.
Quatre types d’obstacles perçus ont été mis en évidence dans le cadre de cette recherche :
- Barrières physiques : limites liées au vieillissement des infrastructures, à des budgets d’entretien restreints et à l’insuffisance d’installations accessibles.
- Obstacles financiers : préoccupations liées au risque que la perception d’un loyer affecte le statut caritatif et l’exemption fiscale d’un lieu de culte, ou qu’elle soit perçue comme incompatible avec sa mission caritative.
- Obstacles opérationnels : difficultés de communication attribuables à un manque de capacités internes, ce qui complique la gestion des locations d’espaces.
- Barrières culturelles: difficultés relationnelles qui émergent lorsque l’un ou l’autre groupe perçoit ses valeurs comme incompatibles avec celles de l’autre, ce qui fait naître des différences qui peuvent ou non refléter de véritables incompatibilités. S’ajoutent à cela des tensions liées à un sentiment de manque de neutralité au sein de certaines communautés religieuses, rendant leurs bâtiments moins accueillants. Plusieurs de ces tensions trouvent leur origine dans l’exclusion historique persistante des personnes 2ELGBTQQIA+ au sein de milieux religieux, ainsi que dans les séquelles durables des préjudices infligés aux peuples autochtones par des organisations religieuses au Canada.
Par cette recherche, la Fiducie nationale du Canada entend encourager de nouveaux partenariats entre les communautés confessionnelles et les organismes sans but lucratif locaux. Les résultats révèlent que nombre de groupes confessionnels et communautaires ont des valeurs et des objectifs communs, comme celui d’offrir à leurs membres des espaces sûrs où ils peuvent collaborer, s’engager et s’entraider. Le partage des espaces joue un rôle essentiel pour maintenir les édifices religieux comme lieux communautaires vivants, tout en élargissant la portée et la diversité des services offerts à la population. Grâce à leur mise en valeur par la communauté, ces lieux de culte historiques demeurent actifs et pertinents, et continuent d’incarner un pan essentiel du patrimoine local.
Téléchargez notre Liste de vérification pour le partage des espaces.
[1]Louis Cornelissen, « La religiosité au Canada et son évolution de 1985 à 2019 », Regards sur la société canadienne (Statistique Canada, 28 octobre 2021). 5-6. https://www150.statcan.gc.ca/n1/fr/pub/75-006-x/2021001/article/00010-fra.pdf?st=SKao0pIN.